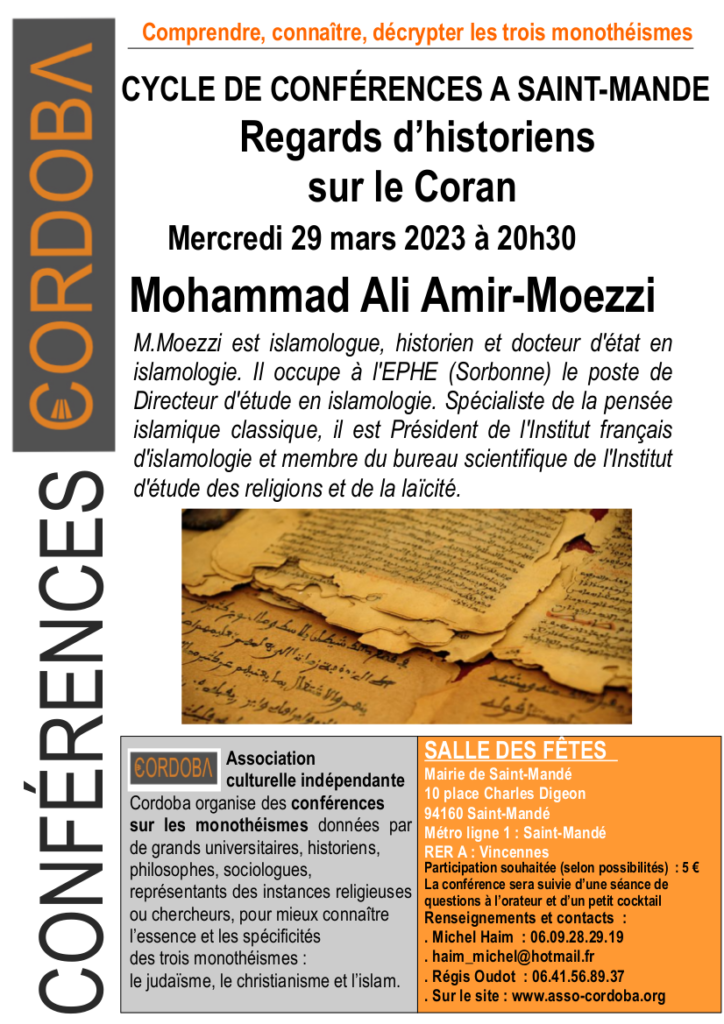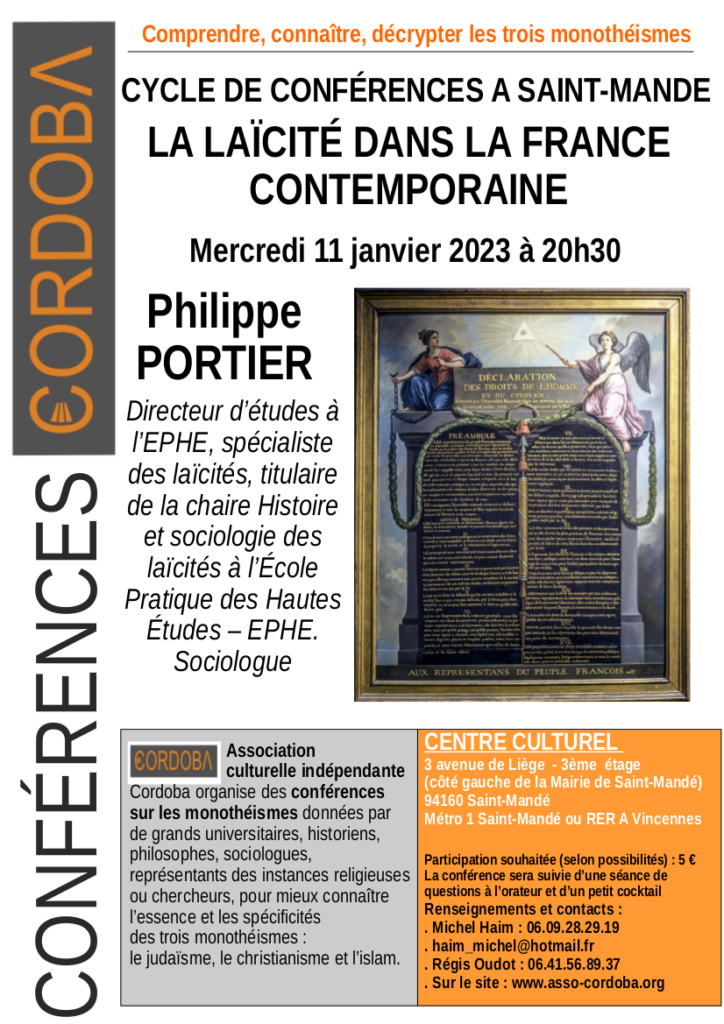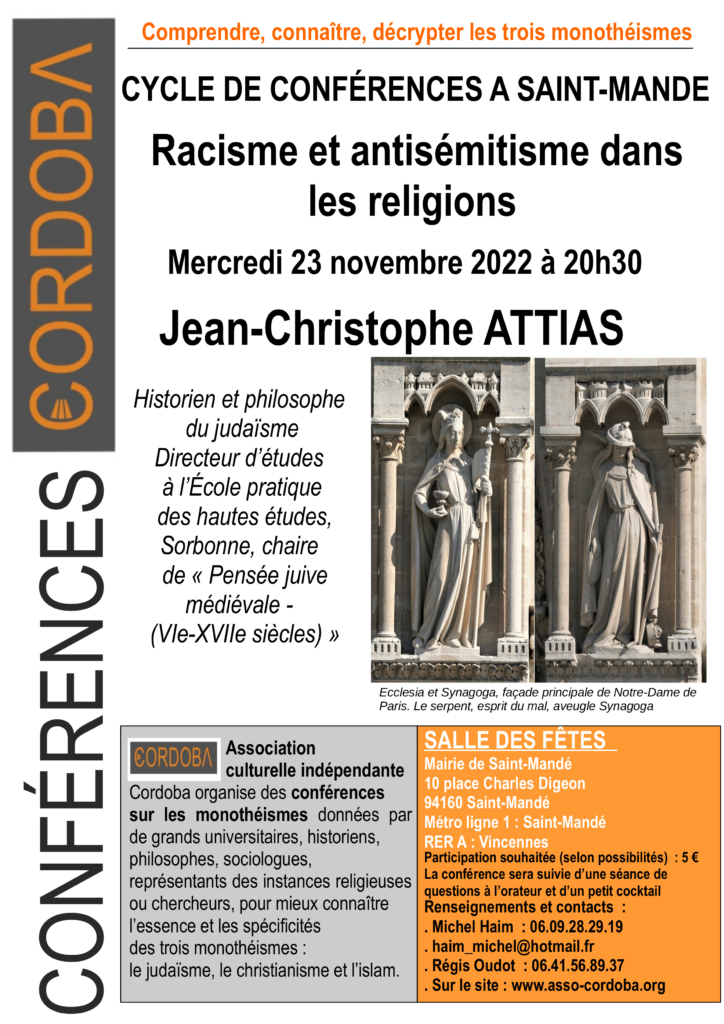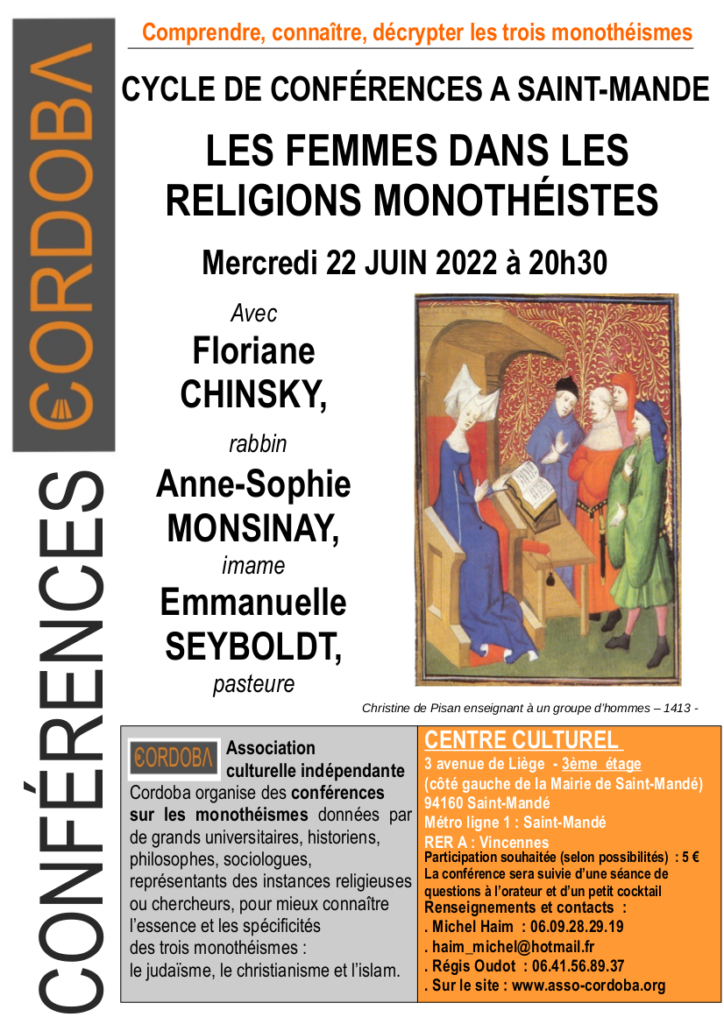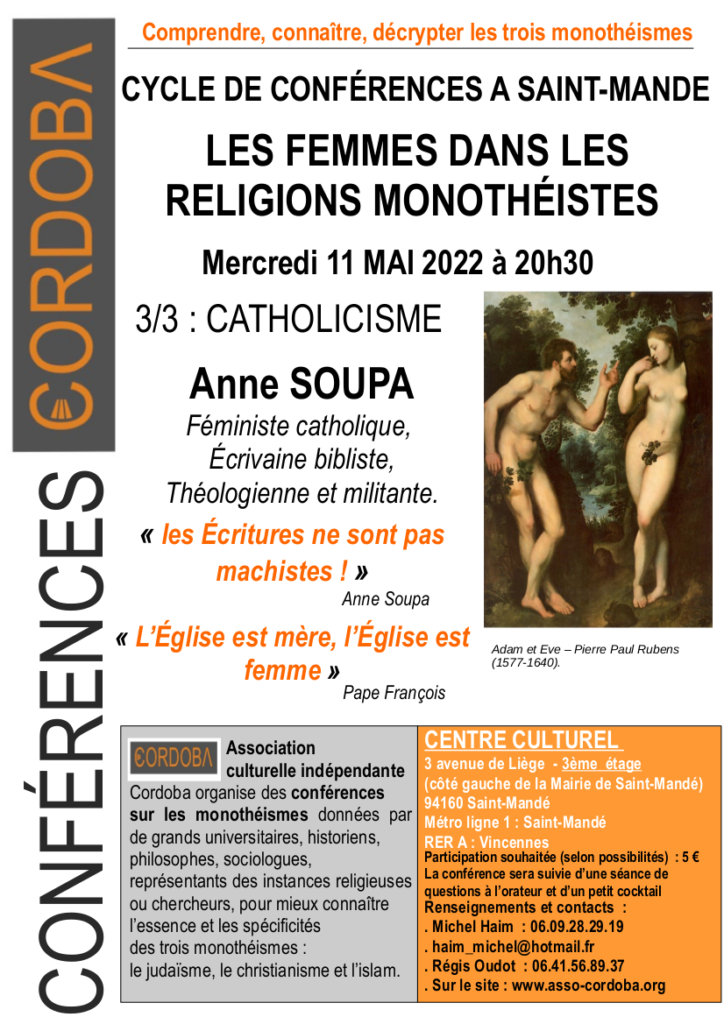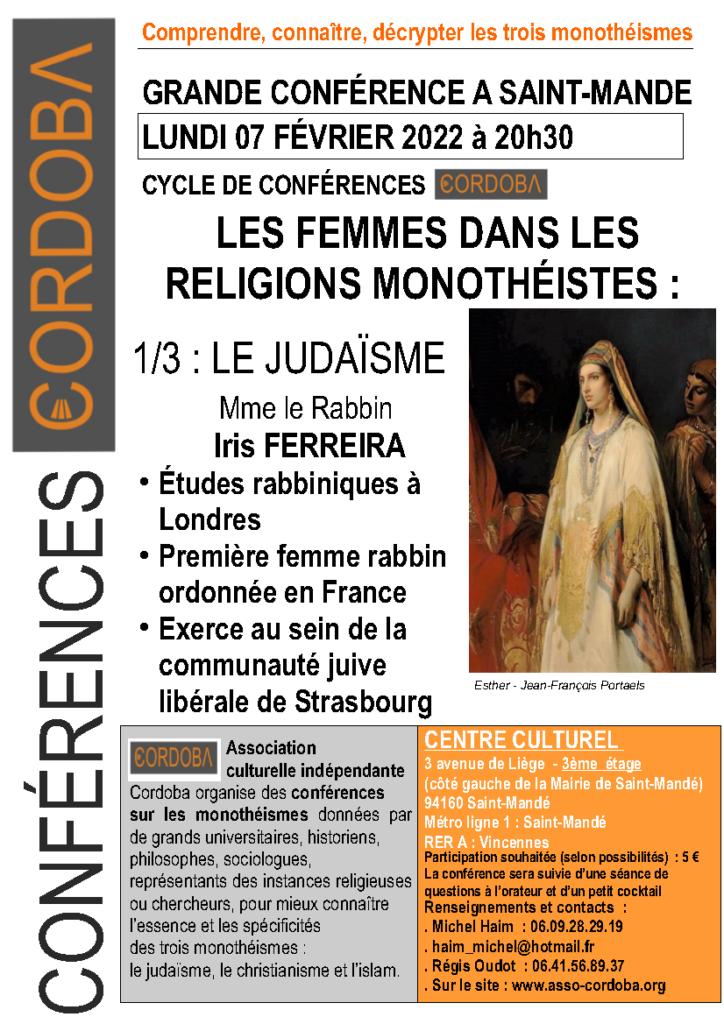Conférencier de M. Jean-Dominique Durand, historien, professeur émérite d’Histoire contemporaine à l’Université Jean Moulin-Lyon 3. Depuis, Président de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France.

Résumé de la conference et article de CORDOBA.
L’histoire judéo-chrétienne, telle que décrite dans les sources, est une histoire complexe et passionnelle, pleine de malentendus, de persécutions et de souffrances, mais qui a connu de profondes révolutions et évolutions au cours du temps.
I. Les Origines de la Rupture et l’Enseignement du Mépris
Les Débuts et la Séparation À l’origine, les premiers Chrétiens se considéraient comme des Juifs dans le contexte d’un judaïsme non monolithique, et on pouvait parler de communautés judéo-chrétiennes. Jésus se présentait comme le Messie d’Israël, intégré à l’alliance par sa circoncision au sein de la foi juive, tout en destinant une nouvelle inouïe à l’humanité entière.
La rupture entre le catholicisme et le judaïsme, dont témoignent les Actes des Apôtres et les Épîtres de Paul, est liée à deux questions fondamentales :
1. L’interprétation de la mission de Jésus : La différence d’interprétation de Jésus comme Messie, mort et ressuscité, et le salut par la Croix, fondement d’une nouveauté radicale au cœur de l’Alliance.
2. La mission auprès des païens : Le baptême se substituant à la circoncision, et les Gentils entrant dans le Peuple de Dieu. Les Juifs y voyaient une remise en cause de la Torah.
Après l’an 70, l’idée s’est développée chez les Chrétiens que la destruction du Temple et la ruine de Jérusalem prouvaient la disqualification du peuple juif, condamné à la dispersion et à l’errance pour n’avoir pas reconnu le Messie attendu. Saint Augustin a notamment contribué à cette vision dans La Cité de Dieu.
Le Quadruple Refus et l’Antijudaïsme Cette rupture initiale fut accentuée par les Pères de l’Église qui développèrent un enseignement hostile au judaïsme, fondé sur l’accusation de déicide et un mépris absolu. Le judaïsme fut dès lors considéré comme une religion à combattre.
Cette histoire est marquée par un quadruple refus ou récusation du judaïsme par le christianisme :
1. Le refus de reconnaître le judaïsme : Représenté par les statues de l’Église (triomphante et couronnée) et de la Synagogue (se détournant, les yeux bandés, symbole du refus de reconnaître le Christ, parfois bandés par un serpent, comme à Notre-Dame de Paris ou Strasbourg).
2. Le refus de la connaissance de l’autre : Symbolisé par l’interdiction d’enseigner le Talmud (Saint Louis le fit brûler) et la méconnaissance ou le mépris de l’Ancien Testament (pour les Catholiques, il fallut attendre Vatican II).
3. Le refus de vivre ensemble : Conduit à l’organisation des ghettos, la séparation physique, les interdictions professionnelles, les expulsions, et les conversions forcées. Les Juifs étaient souvent des boucs émissaires en cas de crise (maladies, épidémies).
Cet antijudaïsme religieux, nourri au fil des siècles, a ensuite débouché au XIXe siècle sur un antisémitisme racial et social. Bien que la distinction soit faite entre les deux, le passage de l’un à l’autre est considéré comme naturel, l’antijudaïsme ayant fait prospérer les préjugés antisémites (préjugés de race, de richesse, de domination mondiale).
II. Le Rapprochement et le Rôle de Jules Isaac
L’Ambiguïté du Philo-sémitisme Dès le XVIIIe siècle, et surtout au XIXe siècle, certains Chrétiens ont cherché l’amitié et la compréhension du judaïsme (comme l’abbé Grégoire). Ce courant, appelé philosémitisme, visait à redécouvrir le judaïsme à travers ses fêtes et ses textes. Des auteurs comme Léon Bloy (Le Salut par les Juifs, 1892), Anatole Leroy-Beaulieu et Charles Péguy en ont été des figures importantes, notamment face aux crises antisémites comme l’Affaire Dreyfus.
Cependant, le philosémitisme n’était pas sans ambiguïté et contenait souvent la tentation du prosélytisme. Le modèle d’Alphonse Ratisbonne, converti en 1842 et fondateur d’une congrégation visant à convertir les Juifs, illustre cette tendance. Le prosélytisme, même subtil, n’est pas considéré comme un dialogue.
La Révolution de la Shoah et l’Action de Jules Isaac L’histoire judéo-chrétienne a connu une véritable révolution après le traumatisme de la Shoah, réalisée en terre chrétienne, et qui a forcé une interrogation sur la responsabilité du développement de l’antisémitisme chrétien.
L’historien Jules Isaac (cofondateur des manuels d’histoire Malet-Isaac) a été la figure prophétique de ce tournant. Son action découle directement de la Shoah, ayant perdu sa femme et sa fille, Lorette et Juliette Isaac, assassinées par les Nazis à Auschwitz.
Son livre fondamental, Jésus et Israël (dont on célèbre le 75e anniversaire), a été une révolution qui a secoué les consciences. Isaac a mené un combat de vérité en agissant en tant qu’historien, revenant aux textes fondateurs pour démontrer que l’enseignement chrétien du mépris (dans lequel il voyait l’origine de la Shoah) était fondé sur des interprétations erronées de la Bible et du récit de la Passion.
En 1947, le choc de la Shoah a conduit à une redécouverte du lien vital entre christianisme et judaïsme lors de la rencontre de Seelisberg (Suisse), où Jules Isaac et le Grand Rabbin Jacob Kaplan ont joué un rôle majeur, publiant les Dix Points de Seelisberg.
L’Amitié Judéo-Chrétienne de France (AJCF) a été fondée dans la foulée, en 1948, pour jouer un rôle majeur dans la connaissance mutuelle. L’AJCF est claire dans ses statuts et intentions : il n’est pas question d’essayer d’attirer l’autre vers sa propre religion.
III. Les Tournants du Concile Vatican II et de Jean-Paul II
Nostra Ætate (1965) Jules Isaac a œuvré inlassablement, allant jusqu’à rencontrer les Papes (Pie XII en 1949, Jean XXIII en 1960) pour convaincre la hiérarchie catholique de la nécessité de réviser l’enseignement chrétien. Le Pape Jean XXIII, frappé par l’expression « l’enseignement du mépris », lança la réflexion, confiant le projet au Cardinal Béa.
Malgré de vives oppositions (provenant des Églises du Moyen-Orient, d’une partie du monde catholique restant sur des positions de défiance héritées de l’antijudaïsme, et des intégristes qui y voyaient la « main des Juifs » contrôlant le Concile), la déclaration Nostra Ætate (point 4) fut votée en 1965.
Ce texte a marqué un tournant fondamental et une « deuxième révolution » :
• Le peuple juif ne peut plus être considéré comme coupable de déicide.
• Il reconnaît un lien fort entre christianisme et judaïsme.
• Il a défini théologiquement, pour la première fois de façon explicite, les relations de l’Église catholique avec le judaïsme.
• Jules Isaac, décédé en 1963, est considéré comme l’auteur indirect de Nostra Ætate, un fait noté avec étonnement par Monseigneur de Provenchères, soulignant l’initiative d’un « laïc, un laïc juif » à l’origine d’un décret conciliaire.
Les Évolutions sous Jean-Paul II Le pontificat de Jean-Paul II a été essentiel pour l’approfondissement du lien judéo-chrétien, notamment grâce à sa connaissance personnelle du judaïsme (étant né à Wadowice, en Pologne, où 40% de la population était juive, et ayant été archevêque de Cracovie, diocèse d’Auschwitz).
Ses contributions incluent :
• La reconnaissance en 1980 de la validité actuelle de l’Alliance de Dieu avec le peuple d’Israël, Alliance qui n’a « jamais été révoquée ».
• La visite à la Synagogue de Rome en 1986, où il a qualifié les Juifs de « frères aînés », affirmant que la religion juive est intrinsèque à la religion chrétienne, faisant des relations judéo-chrétiennes des relations intrafamiliales.
• Des gestes forts, comme la célébration solennelle de la repentance en 2000 pour les péchés de l’Église au cours des siècles, la reconnaissance de l’État d’Israël en 1993 (avec un passage fondamental sur l’importance de la Terre pour les Juifs), et son pèlerinage en Israël, marqué par sa visite à Yad Vashem et sa prière au Kotel.
IV. Le Dialogue Actuel et les Défis Persistants
L’œuvre de rapprochement se poursuit sous Benoît XVI et le Pape François. Le Pape François a affirmé en 2016 : « Oui à la redécouverte des racines juives du christianisme, non à toute forme d’antisémitisme, et condamnation de toute injure, discrimination, persécution qui en découle ».
L’Asymétrie et la Méfiance Le dialogue n’est pas toujours facile et reste souvent asymétrique. Les Chrétiens portent un grand intérêt au judaïsme car, sans le judaïsme et le Premier Testament (l’Ancien Testament), ils ne comprennent rien à leur propre foi (le Notre Père et l’Eucharistie étant ancrés dans le judaïsme). À l’inverse, les Juifs peuvent très bien se passer du christianisme (qui leur a d’ailleurs apporté tant de misère).
Cette asymétrie engendre une grande méfiance ou peur chez les Juifs, principalement celle de la conversion (prosélytisme). Cette crainte est historique, étant donné les nombreuses conversions forcées. L’inquiétude revient facilement car il est impossible d’effacer d’un trait de plume deux millénaires de haine et de persécution.
Persistance des Crises et Travail Historique Des crises récurrentes peuvent survenir, comme l’affaire du Carmel d’Auschwitz, le projet de béatification des Papes Pie IX et Pie XII (avec la question de son « silence »), ou une catéchèse maladroite (comme celle du Pape François sur l’Épître de Paul aux Galates). Le dialogue exige de ne pas laisser prospérer ces problèmes.
Le travail se fait sur trois plans :
1. Théologique : Connaissance des textes pour répondre aux interprétations erronées.
2. Historique : Examiner rigoureusement les faits (par exemple, sur le rôle de Pie XII).
3. Citoyen : Occuper l’espace public, multiplier les contacts avec les pouvoirs publics et œuvrer pour les commémorations, notamment face à la disparition des témoins de la Shoah.
Développement du Dialogue et des Liens Concrets Pour approfondir le dialogue au-delà des ouvertures de Nostra Ætate, il est nécessaire de pénétrer dans la tradition juive et de la comprendre de l’intérieur, reconnaissant une vraie filiation et réalisant que la parole de salut est venue par leur intermédiaire.
Le dialogue ne se limite pas aux échanges intellectuels ou à l’analyse des textes. Les groupes locaux de l’AJCF organisent des fêtes communes, des concerts, et des partages liturgiques (par exemple, participer au Shabbat), visant à développer des relations plus ouvertes et concrètes.
Aujourd’hui, l’évolution de ces relations est symbolisée par le monument de Joshua Kaufman, Synagoga and Ecclesia in Our Time, où la Synagogue (portant la Torah) et l’Église (portant l’Évangile) se parlent comme deux sœurs, représentant un « dialogue serein ». Toutefois, comme le dit le Pape François, l’œuvre de Jules Isaac n’est pas terminée et nécessite une vigilance constante.
Jules Isaac.
Jules Isaac (décédé en janvier 1963) est reconnu comme une figure fondamentale et prophétique dans la révolution des relations judéo-chrétiennes au XXe siècle. Il est célèbre en tant que co-auteur des manuels d’histoire Malet-Isaac et était historien de profession.
Son action est qualifiée de « véritable révolution » qui a incroyablement secoué les consciences et posé les bases de l’amitié et de l’estime entre Juifs et Chrétiens.
I. Le Traumatisme de la Shoah et le Combat contre l’Enseignement du Mépris
L’engagement de Jules Isaac est profondément ancré dans le traumatisme de la Shoah, réalisée en terre chrétienne. Son action prophétique trouve son origine dans la tragédie personnelle d’avoir perdu sa femme et sa fille, Lorette et Juliette Isaac, assassinées par les Nazis à Auschwitz parce qu’elles s’appelaient Isaac.
En tant qu’historien, Isaac a mené un combat de vérité. Il a voulu revenir aux textes fondateurs, les décortiquer et les analyser pour démontrer que « l’enseignement du mépris » (qu’il considérait comme l’origine de la Shoah et de la persécution extrême) était basé sur des interprétations erronées de la Bible et du récit de la Passion. Son objectif était de renverser l’erreur et d’effacer les interprétations qui entretenaient la haine des Juifs.
L’archevêque d’Aix-en-Provence, Monseigneur D’Ornellas, a salué son travail en le décrivant comme un « génie providentiel » et un exemple pour les professeurs d’histoire cherchant à corriger tout enseignement qui produit de la haine et conduit à la barbarie, comme l’antisémitisme engendré par l’enseignement chrétien qui a mené à Auschwitz.
II. Les Œuvres Clés et l’Action Institutionnelle
Jésus et Israël Son livre fondamental, Jésus et Israël, est considéré comme l’un de ses ouvrages majeurs. La date de sa parution (dont on célèbre le 75e anniversaire) est considérée comme l’une des deux « révolutions » dans l’histoire des relations judéo-chrétiennes, la seconde étant Nostra Ætate. Ce livre est dédié à sa femme et à sa fille.
Fondation et Dialogue de Seelisberg Le choc de la Shoah a conduit à la redécouverte du lien vital entre christianisme et judaïsme lors de la rencontre de Seelisberg (Suisse alémanique) en 1947. Jules Isaac y a joué un rôle majeur, aux côtés du Grand Rabbin Jacob Kaplan, dans la publication des Dix Points de Seelisberg.
Dans la foulée de Seelisberg, Jules Isaac a cofondé l’Amitié Judéo-Chrétienne de France (AJCF) en 1948, avec le Grand Poète Edmond Fleg, le pasteur Jacques Martin, et Henri René Marrou. Les statuts et les intentions de l’AJCF, sous l’impulsion d’Isaac, sont très clairs : il n’est pas question d’essayer d’attirer l’autre vers sa propre religion (évitant ainsi la tentation du prosélytisme).
Intervention auprès du Vatican Jules Isaac fut infatigable dans son engagement. Il a compris qu’il fallait « taper à la tête » de l’Église catholique, étant donné son organisation hiérarchique.
• Il a rencontré le Pape Pie XII en 1949 pour discuter notamment de la prière du Vendredi Saint considérée comme injurieuse, où les Juifs étaient appelés « perfides » et pour laquelle on ne s’agenouillait pas, signe de mépris à l’encontre des Juifs.
• Il a rencontré le Pape Jean XXIII en 1960. Au cours de cet entretien, il a parlé au Pape de « l’enseignement du mépris », une expression qui a vivement choqué et frappé Jean XXIII.
• Jean XXIII, préoccupé par cette relation, a confié la réflexion au Cardinal Béa, que Jules Isaac a également rencontré. Durant cet entretien, Isaac a pu développer ses convictions et convaincre le Cardinal.
III. L’Héritage : L’Auteur Indirect de Nostra Ætate
Bien que Jules Isaac soit mort avant le vote de la déclaration conciliaire, il est considéré comme l’auteur indirect de Nostra Ætate (Point 4), l’un de ses Pères fondateurs. Le texte, voté en 1965, marque un tournant fondamental en affirmant notamment que le peuple juif ne peut plus être considéré comme coupable de déicide.
Le rôle d’Isaac est d’autant plus remarquable que Monseigneur Charles de Provenchères, archevêque d’Aix-en-Provence, a souligné avec stupéfaction que l’initiative d’un décret conciliaire étudié et voté par 2000 évêques provenait d’un laïc, et d’un laïc juif.
Même si un grand chemin a été parcouru, le Pape François a rappelé en 2022 que « l’œuvre de Jules Isaac n’est pas terminée » et qu’il est nécessaire de veiller à poursuivre cette tâche colossale.
L’histoire des relations entre chrétiens et juifs est profondément marquée par une distinction essentielle, quoique complexe et controversée, entre l’antijudaïsme religieux et l’antisémitisme racial et social.
Les sources établissent que l’antijudaïsme, nourri par des causes religieuses au fil des siècles, est le terreau historique à partir duquel l’antisémitisme moderne a pu prospérer.
1. L’Antijudaïsme : La Haine Religieuse
L’antijudaïsme trouve son origine dans la rupture entre le christianisme et le judaïsme et est alimenté par des raisons purement religieuses.
- Fondement : Il s’est développé à travers un enseignement hostile des Pères de l’Église, fondé sur l’accusation de déicide et sur un mépris absolu à l’encontre des Juifs. Le judaïsme était dès lors considéré comme une religion à combattre.
- Conséquences : Ce corpus doctrinal est ce que l’historien Jules Isaac a dénoncé comme l’« enseignement du mépris ». Historiquement, il s’est traduit par :
- Le refus de reconnaître la validité du judaïsme.
- Le refus de la connaissance de l’autre (ex. : l’interdiction d’enseigner le Talmud).
- Le refus de vivre ensemble (organisation des ghettos, expulsions, conversions forcées).
- Le rôle de bouc émissaire systématique des Juifs en cas de crise (maladies, famines).
2. L’Antisémitisme : La Haine Raciale et Sociale
L’antisémitisme, quant à lui, est une forme de haine qui s’est affirmée au XIXe siècle et dont la nature est principalement raciale et sociale.
3. Le Lien de Causalité et la Lutte Actuelle
Causalité historique
Bien qu’une distinction doive être faite, le conférencier insiste sur le fait qu’elle est « très spécieuse », car le passage de l’un à l’autre s’est fait naturellement.
- C’est dans l’antijudaïsme religieux que sont nés et ont prospéré tous les préjugés antisémites (préjugés de race, de richesse, de volonté de domination mondiale, etc.).
- L’« enseignement du mépris » est ainsi considéré comme le terreau qui a rendu possible la Shoah et la persécution extrême au XXe siècle.
- Le problème persiste aujourd’hui à travers l’antisémitisme passif, presque inconscient, où les esprits restent imprégnés de ces préjugés millénaires sur les Juifs (richesse, pouvoir, intelligence).
La lutte moderne
Le dialogue actuel, fortement influencé par Jules Isaac et la déclaration conciliaire Nostra Ætate (1965), vise à déconstruire les deux formes de haine :
- Antijudaïsme : Il est considéré comme l’affaire des Chrétiens, car il est né de leur propre histoire religieuse. La lutte passe par un travail théologique et une révision des textes pour éliminer les interprétations erronées.
- Antisémitisme : Il est l’affaire de la société tout entière et nécessite un engagement civique, y compris des actions pour la mémoire (commémorations de la Shoah) et la condamnation de toute forme de haine.
L’objectif, réaffirmé par le Pape François en 2016, est le « non à toute forme d’antisémitisme, et condamnation de toute injure, discrimination, persécution qui en découle ».
Déclaration Nostra Ætate.
La Déclaration Nostra Ætate (plus précisément le Point 4 de cette déclaration), votée en 1965 durant le Concile Vatican II, est qualifiée de « deuxième révolution » et de « tournant fondamental » dans l’histoire de l’Église catholique et dans les relations judéo-chrétiennes.
I. La Genèse de la Déclaration
L’initiative de la Déclaration Nostra Ætate est intimement liée à l’action de l’historien juif Jules Isaac, co-auteur des manuels Malet-Isaac.
L’Impulsion de Jean XXIII La décision de lancer une réflexion sur les relations avec le judaïsme fut prise par le Pape Jean XXIII lui-même. Jean XXIII était profondément préoccupé par cette relation, ayant personnellement organisé le sauvetage de milliers de Juifs des Balkans, de Grèce et de Bulgarie durant la Seconde Guerre mondiale.
Le Rôle Prophétique de Jules Isaac En 1960, Jean XXIII reçut l’historien Jules Isaac. Au cours de cet entretien, Isaac parla au Pape de « l’enseignement du mépris », une expression qui a vivement frappé et choqué Jean XXIII. Le Pape confia alors le projet au Cardinal Béa.
Isaac rencontra également le Cardinal Béa, développant ses convictions et parvenant à le convaincre, un Béa qui était déjà « largement convaincu » en réalité. Bien que Jules Isaac soit mort en janvier 1963, avant le vote du texte conciliaire, il est considéré comme « l’auteur indirect de Nostra Ætate » et l’un de ses Pères fondateurs.
Monseigneur Charles de Provenchères, archevêque d’Aix-en-Provence, a exprimé sa stupéfaction que l’initiative d’un décret conciliaire, étudié et voté par 2 000 évêques, provienne « d’un laïc, et d’un laïc juif ».
II. Les Apports Théologiques et la Rupture avec l’Antijudaïsme
Nostra Ætate (en particulier son Point 4) a marqué une rupture définitive avec des siècles de doctrine hostile en définissant théologiquement, pour la première fois de façon explicite, les relations de l’Église catholique avec le judaïsme.
Les points fondamentaux établis par le texte sont :
1. L’abandon de l’accusation de déicide : Le peuple juif ne peut plus être considéré comme coupable de déicide.
2. Reconnaissance du lien fort : Le texte reconnaît un lien fort entre christianisme et judaïsme. Il est souvent souligné, avec étonnement, qu’il a fallu deux millénaires pour que l’Église reconnaisse que Jésus, les Apôtres, et tous ses disciples étaient Juifs, et que Jésus était le fils d’une mère juive.
3. Redécouverte des racines : La Déclaration a tracé la route, affirmant un « oui à la redécouverte des racines juives du christianisme ».
L’Église n’avait, jusqu’alors, jamais produit de document doctrinal sur le judaïsme.
III. Les Oppositions et les Difficultés
Le processus d’adoption de Nostra Ætate fut ardu, rencontrant de nombreuses et vives oppositions. Le texte fut d’abord rejeté en juin 1962 par la commission préparatoire, puis réintroduit sous la pression du Saint-Père et annexé au texte sur l’œcuménisme.
Les oppositions venaient de divers horizons :
• Motivations Diplomatiques : Les Églises chrétiennes du Moyen-Orient craignaient des conséquences négatives pour elles dans le contexte tendu de la Terre Sainte et de leurs relations complexes avec le jeune État d’Israël et le monde musulman.
• Résistance Catholique Traditionnelle : Une partie du monde catholique restait sur des positions de défiance nourries par l’antijudaïsme hérité, se demandant comment dépasser la doctrine établie pendant des siècles par les Pères de l’Église.
• Integrisme et Conspiration : Des traditionalistes, y compris Monseigneur Lefebvre, répandaient des pamphlets contre ce texte, soulignant le caractère « maudit et nuisible du peuple déicide ». D’autres diffusaient l’idée que le texte était l’œuvre de la « main des Juifs », qui contrôleraient le Concile, y compris le Cardinal Béa.
Pour atténuer certaines oppositions, le choix final fut d’élargir le sujet aux autres religions non chrétiennes (religions orientales et Islam).
IV. L’Héritage et la Poursuite de l’Œuvre
Même si beaucoup reconnaissent les limites de Nostra Ætate, le texte a ouvert une voie et libéré des initiatives dans les Églises locales.
L’Approfondissement Doctrinal Nostra Ætate a été complété par d’autres textes, comme les Orientation et suggestions pour l’application de la déclaration conciliaire Nostra Ætate publié par le Pape Paul VI en 1974, qui condamne l’antisémitisme comme étant opposé à l’esprit même du christianisme.
Le Pape Jean-Paul II a continué dans cette voie, notamment en reconnaissant en 1980 la validité actuelle de l’Alliance de Dieu avec le peuple d’Israël qui « n’a jamais été révoquée ».
Le Pape François a réaffirmé en 2016 que le Concile, avec Nostra Ætate, a tracé la route : « oui à la redécouverte des racines juives du christianisme, non à toute forme d’antisémitisme, et condamnation de toute injure, discrimination, persécution qui en découle ».
Le Travail Inachevé Des théologiens comme Michel Remond ont souligné que s’arrêter à Nostra Ætate serait insuffisant ; il faut « creuser, approfondir » et pénétrer la tradition juive pour reconnaître une vraie filiation et ne pas se contenter d’un simple lien généalogique.
Malgré les avancées, le dialogue reste exigeant, et le Pape François a récemment rappelé que « l’œuvre de Jules Isaac n’est pas terminée », nécessitant une vigilance constante pour poursuivre cette « tâche colossale ».
Dialogue interreligieux.
Le dialogue interreligieux, tel qu’il est abordé dans les sources, se concentre principalement sur l’évolution complexe et historique du dialogue judéo-chrétien et sa distinction en tant que relation « intrafamiliale ». Ce dialogue est né d’une volonté de dépasser deux millénaires de haine, de méfiance, de persécution et de malentendus.
I. La Nature Particulière du Dialogue Judéo-Chrétien
Une Relation Intrafamiliale Le dialogue entre Juifs et Chrétiens est considéré par le Pape Jean-Paul II, lors de sa visite à la Synagogue de Rome en 1986, comme étant intrinsèque à la religion chrétienne. Par conséquent, les relations judéo-chrétiennes ne relèvent pas des relations interreligieuses, mais plutôt de relations intrafamiliales.
Cette nature intrafamiliale implique une vérité fondamentale pour les Chrétiens : sans le judaïsme et le Premier Testament (Ancien Testament), ils ne comprennent rien à leur propre foi. Par exemple, la prière du Notre Père et l’Eucharistie (la Cène) sont des pratiques juives.
L’Asymétrie du Dialogue Le dialogue est souvent asymétrique. Les Chrétiens ont un grand intérêt pour le judaïsme, car ils ne peuvent pas se passer des Juifs ou du judaïsme. En revanche, les Juifs peuvent très bien se passer du christianisme, d’autant plus que le christianisme leur a historiquement apporté tant de misère.
II. Les Fondements du Dialogue : De Jules Isaac à Nostra Ætate
Le dialogue moderne a été lancé par une véritable révolution suite au traumatisme de la Shoah, réalisée en terre chrétienne.
Le Rôle de Jules Isaac et de l’AJCF L’action prophétique de l’historien Jules Isaac fut essentielle, car il dénonça « l’enseignement du mépris » et l’interprétation erronée des textes qui entretenait la haine des Juifs.
Dans la foulée de la déclaration de Seelisberg (1947), où Jules Isaac et le Grand Rabbin Jacob Kaplan ont joué un rôle majeur, l’Amitié Judéo-Chrétienne de France (AJCF) fut fondée en 1948. L’AJCF joue un rôle majeur dans la connaissance mutuelle.
Le Rejet du Prosélytisme L’une des conditions fondamentales du dialogue, selon les intentions claires de l’AJCF, est que le prosélytisme n’est pas un dialogue. Il n’est pas question d’essayer d’attirer l’autre vers sa propre religion.
Le prosélytisme représente la plus grande méfiance ou peur chez les Juifs en raison de l’histoire des conversions forcées et des persécutions violentes ou subtiles (comme l’affaire Alphonse Ratisbonne). L’inquiétude subsiste face au risque de conversion ou de mariages mixtes, surtout parmi les jeunes, nécessitant une grande prudence de la part des organisateurs chrétiens.
Nostra Ætate et l’Ouverture de la Voie La déclaration conciliaire Nostra Ætate (1965), dont Jules Isaac est considéré comme l’auteur indirect, a marqué un tournant fondamental. Elle a défini théologiquement les relations et a tracé la route pour le dialogue. Le Pape François a rappelé en 2016 que cette déclaration signifie : « oui à la redécouverte des racines juives du christianisme, non à toute forme d’antisémitisme, et condamnation de toute injure, discrimination, persécution qui en découle ».
Le choix final, pour atténuer les oppositions lors du Concile Vatican II, fut d’élargir le sujet aux autres religions non chrétiennes, introduisant des passages sur les religions orientales et l’Islam.
III. Les Modalités et les Défis du Dialogue
Des Actions Concrètes et Locales Le dialogue judéo-chrétien ne doit pas se limiter aux échanges intellectuels ou à l’analyse de textes. Les associations comme l’AJCF s’efforcent d’organiser des relations plus ouvertes et concrètes. Cela inclut :
• L’organisation de fêtes communes, de concerts, et de partages de repas.
• Des partages liturgiques, comme la participation au Shabbat.
L’Approfondissement et les Instruments de Travail Pour aller au-delà du simple lien généalogique reconnu par Nostra Ætate, il est nécessaire, selon le théologien Michel Remond, de « creuser, approfondir » et de pénétrer dans la tradition juive pour la comprendre de l’intérieur et reconnaître une vraie filiation.
Aujourd’hui, l’approfondissement se fait à travers la création de centres d’études juives dans des universités catholiques et la publication d’instruments de travail pour les communautés locales, tels qu’un vade-mecum pour expliquer aux Chrétiens comment dialoguer avec les Juifs.
Les Crispations et la Vigilance Le dialogue est exigeant et fait face à des crises récurrentes (par exemple, l’affaire du Carmel d’Auschwitz, la béatification controversée de Pie XII, ou une catéchèse maladroite du Pape François sur l’Épître de Paul aux Galates). L’inquiétude des Juifs est normale, car on ne peut pas rayer d’un trait de plume deux millénaires de haine et de persécution.
Le travail se poursuit sur trois plans pour garantir un dialogue sain :
1. Théologique : Connaissance des textes pour répondre aux interprétations erronées.
2. Historique : Examen rigoureux des faits (comme le rôle de Pie XII) et des textes des Pères de l’Église, dont certains sont épouvantables.
3. Citoyen : Occuper l’espace public, multiplier les contacts avec les pouvoirs publics, et œuvrer pour les commémorations, notamment face à la disparition des témoins de la Shoah.
IV. Autres Initiatives Interreligieuses
Bien que les sources soient centrées sur le dialogue judéo-chrétien, elles mentionnent l’implication dans des cadres interreligieux plus larges :
• Le locuteur est très impliqué dans le dialogue interreligieux à travers la Communauté de Sant’Egidio, qui organise chaque année un grand rassemblement interreligieux (le prochain étant prévu à Berlin).
• Le Pape François a insisté sur la condamnation de l’antisémitisme tout en reconnaissant les racines juives du christianisme dans le cadre du chemin tracé par Nostra Ætate, qui inclut également l’Islam et les religions orientales.
• Le dialogue s’exprime aussi par l’action conjointe, comme l’ont demandé des intellectuels juifs tels qu’Henri Bergson à Emmanuel Mounier en 1933, de ne pas laisser les Juifs seuls face au mal absolu (comme le nazisme).
Malgré les progrès, le Pape François a récemment rappelé que « l’œuvre de Jules Isaac n’est pas terminée » et qu’il faut veiller à poursuivre cette tâche colossale.
Lien vidéo de la conférence : https://www.youtube.com/watch?v=6AzR5OMtqMU