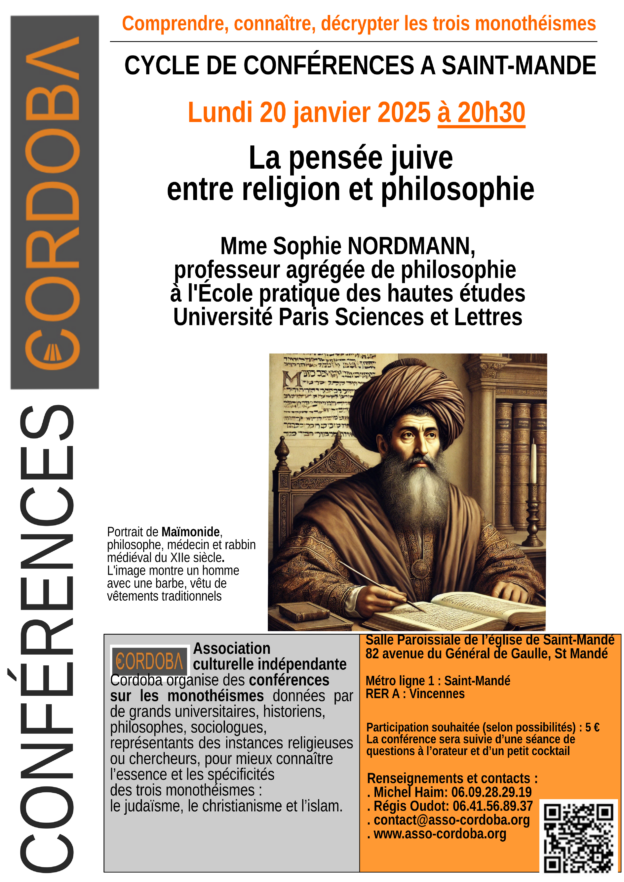Conférence de Mme Sophie Nordmann, professeur agrégée de philosophie à l’École pratique des hautes études Université Paris Sciences et Lettres.
Résumé de la conférence.
La conférence explore l’évolution de la pensée juive et son dialogue avec la philosophie sur 5000 ans, de Jérusalem à Berlin, Cordoue et Amsterdam. Le Tanakh (Torah, Neviim, Ketouvim), canonisé par les pharisiens aux 1er-2e siècles, coïncide avec la naissance du christianisme. Il se distingue par son universalité éthique, illustrée par le récit du déluge avec Noé, homme juste et père d’une humanité fraternelle, contrastant avec des mythes comme Gilgamesh ou Deucalion. Le Talmud (Michna et Guemara), tradition orale mise par écrit après la destruction du second Temple (70), organise des commentaires pratiques par thèmes, marquant le passage du culte au livre. Les pharisiens, devenus dominants face aux Sadducéens ou Esséniens, fondent le judaïsme rabbinique, malgré des contestations comme celle des Karaïtes. Rachi (11e siècle), à Troyes, simplifie l’accès au Tanakh et au Talmud par des commentaires littéraux, influençant le judaïsme ashkénaze après les croisades. Maïmonide, séfarade contemporain, codifie le Talmud dans le Michné Torah pour des Juifs en temps troublés sous les Almohades et concilie Torah et philosophie aristotélicienne dans le Guide des égarés, traduit en hébreu, marquant la pensée juive. Spinoza (17e siècle) rompt avec cette conciliation, séparant raison et révélation dans son Traité théologico-politique, initiant la critique biblique. Issu des Marranes, il reflète un renouvellement des communautés juives post-expulsion ibérique. Mendelssohn (18e siècle), dans Jérusalem, intègre le judaïsme à l’État moderne, distinguant foi privée et loi publique, mais ouvre à l’assimilation, critiquée comme une vision protestante du judaïsme. Levinas, post-Shoah, propose des lectures philosophiques du Talmud aux Colloques des intellectuels juifs, où son éthique de l’Autre (Totalité et Infini) met en garde contre les totalitarismes, valorisant la responsabilité face au visage d’autrui. Le retour à Sion, présent chez Yehouda Halevi, devient politique avec Herzl (19e siècle), impactant la pensée juive en diaspora plus qu’en Israël, notamment après la guerre des Six Jours. La conférence souligne la richesse de la pensée juive, mêlant tradition, commentaire et dialogue universel avec la philosophie.
Lien vidéo de la conférence : https://www.youtube.com/watch?v=lzyq4FhQvB4