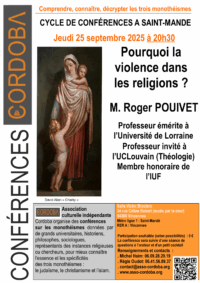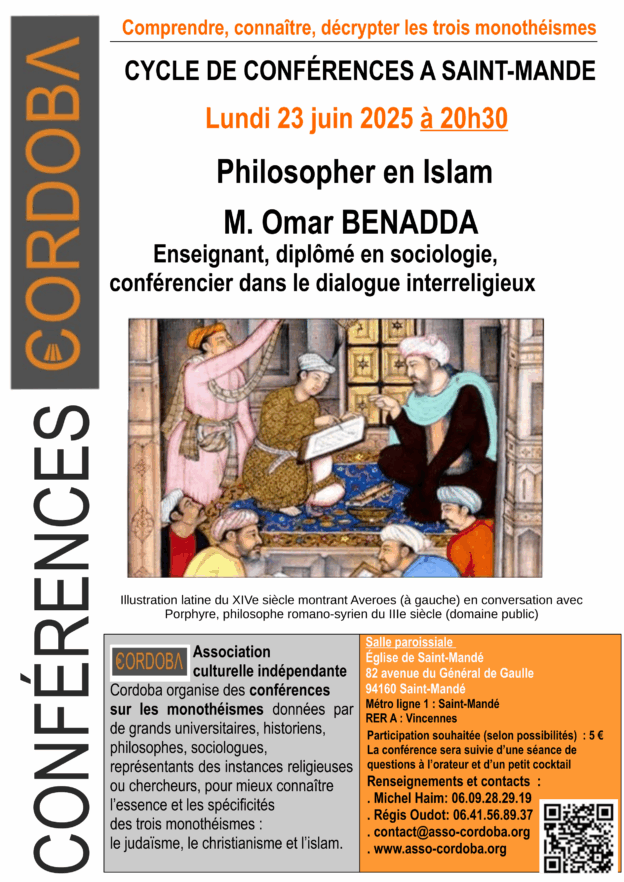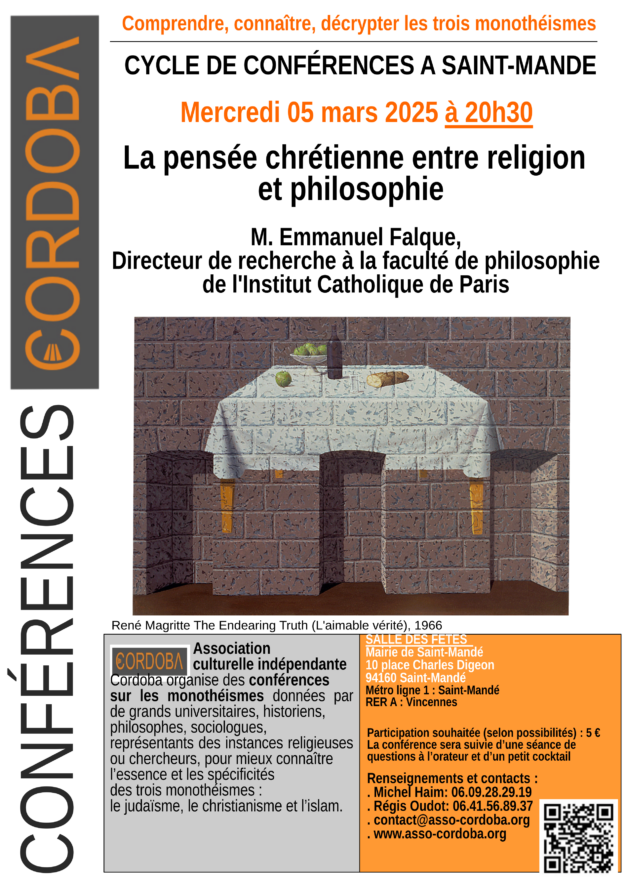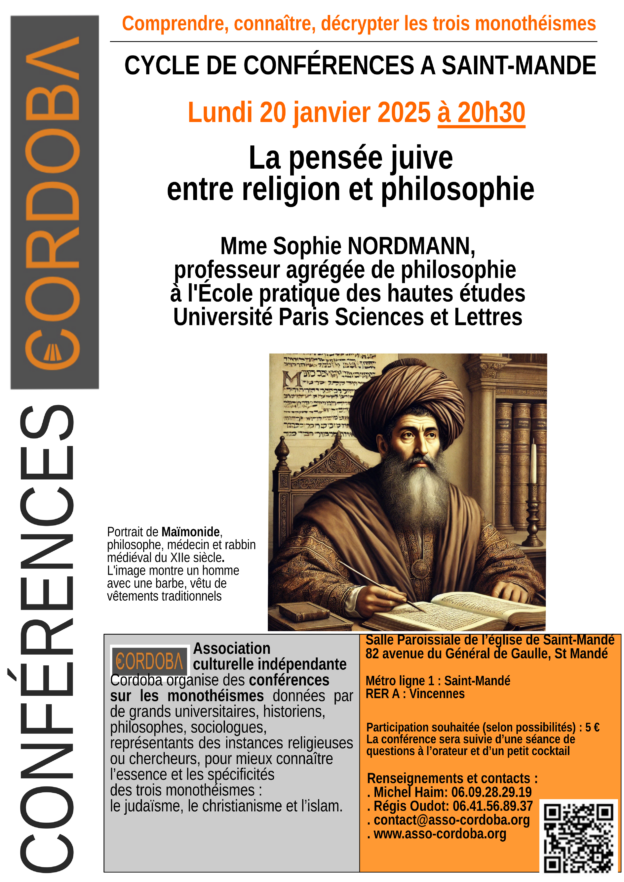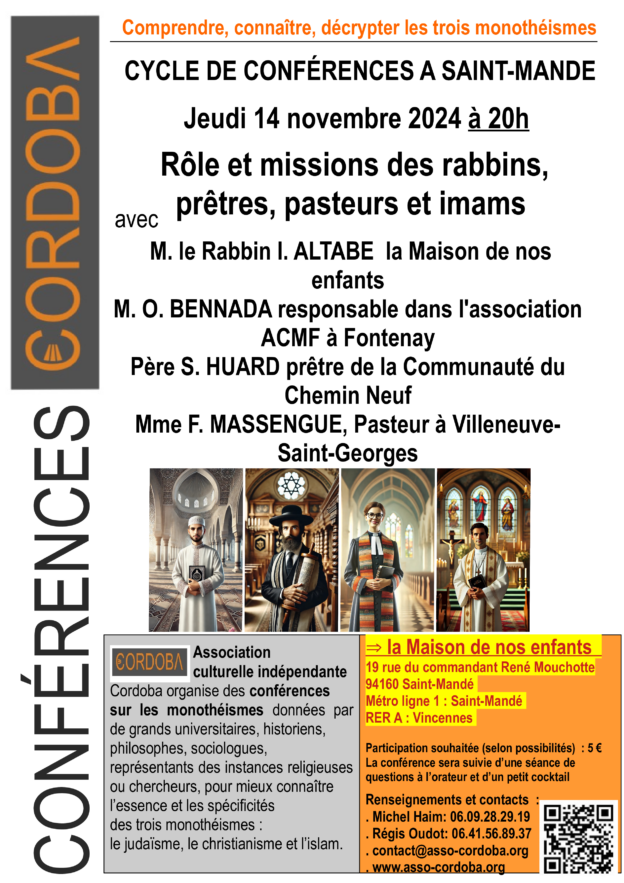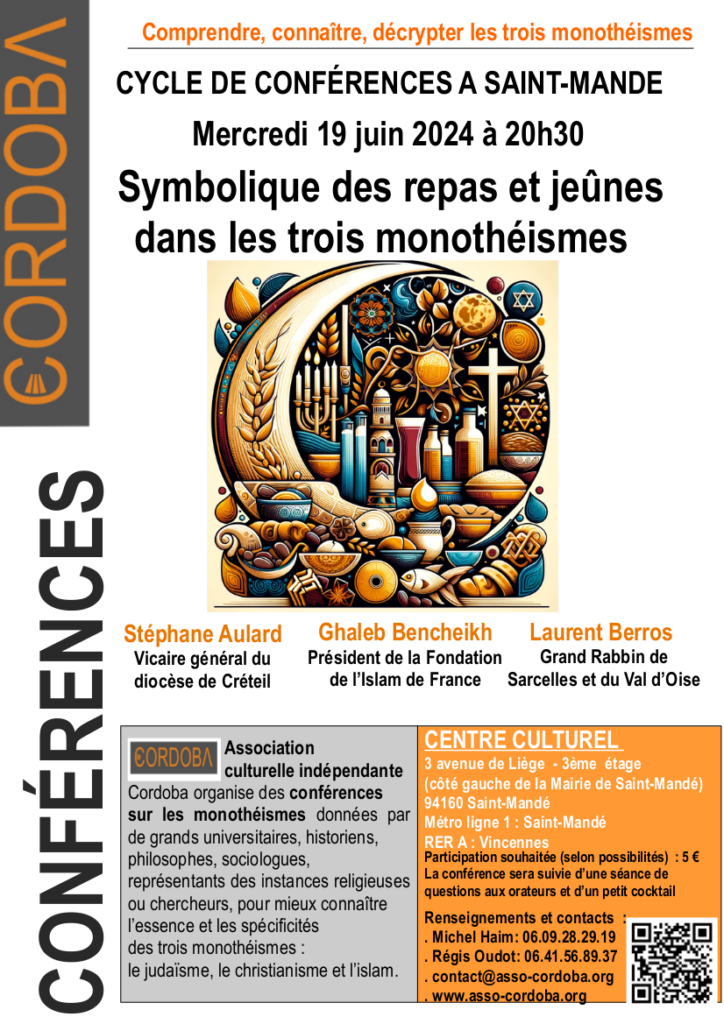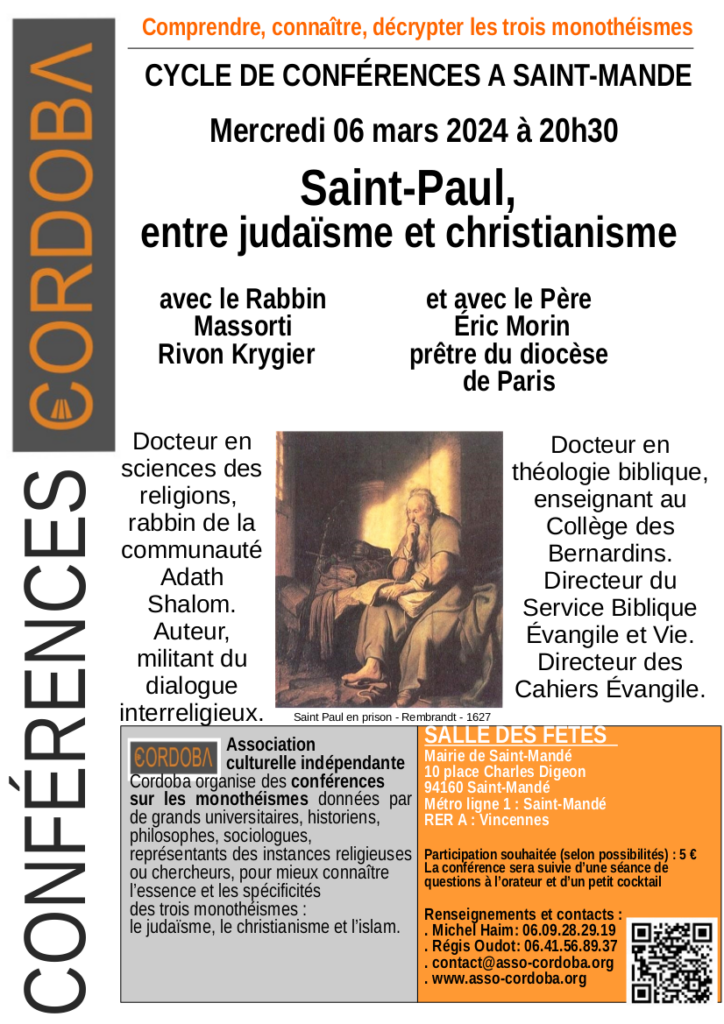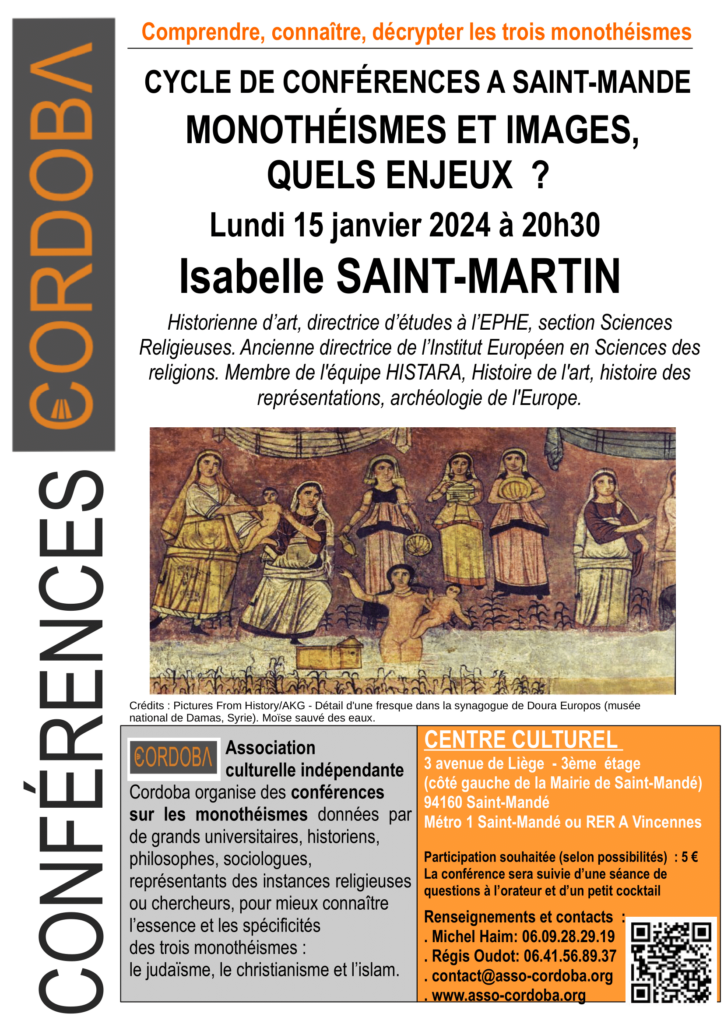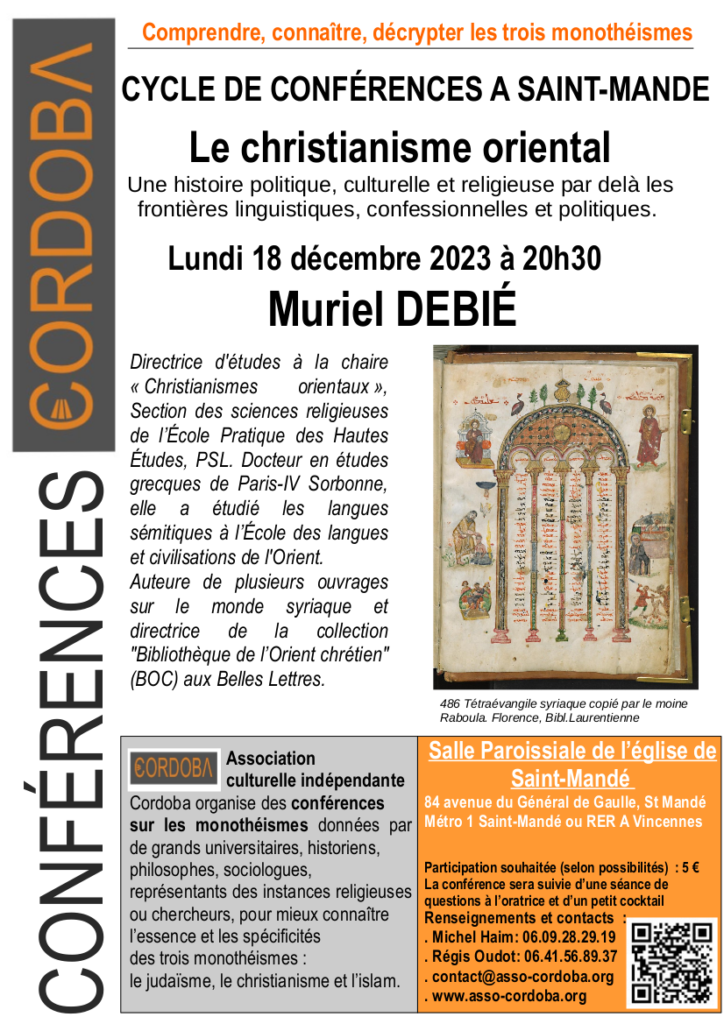Nous avons le plaisir de vous inviter à nous retrouver à la journée des associations le 6 septembre et à notre prochaine conférence le 25 septembre, elle aura lieu dans la salle Brociero, 34 rue CÉLINE ROBERT, à Vincennes, à 20H30 . Attention l’adresse est inhabituelle.
Le thème de la conférence est : Pourquoi la violence dans les religions ? Elle sera animée par M. Roger POUIVET, professeur émérite de l’université de Lorraine. Elle sera suivie d’une séance de questions/ réponses et du pot de l’amitié.
Résumé de la conférence et article de CORDOBA.
Roger Pouivet, philosophe français et professeur à l’université de Lorraine, explore la question complexe de la violence religieuse. Il commence par constater que historiquement, les religions ont été associées à de nombreux épisodes violents : croisades, guerres de religion, persécutions, conversions forcées lors de colonisations, et terrorisme contemporain. Cependant, Pouivet défend la thèse que **les religions ne sont pas intrinsèquement violentes**. S’appuyant sur les travaux de William Cavanaugh, il argue que l’idée de violence religieuse est largement un mythe des Lumières, et que les causes véritables des conflits soi-disant religieux sont en réalité politiques, économiques ou sociales.
Le philosophe distingue *trois types d’exclusivisme religieux* :
1. *L’exclusivisme doctrinal* : chaque religion revendique détenir la vérité absolue
2. *L’exclusivisme sotériologique* : seule la « vraie » foi permet le salut
3. *L’exclusivisme religieux social/politique* : interdiction ou restriction d’autres religions dans la société Sa thèse centrale est que les deux premiers types d’exclusivisme n’impliquent pas nécessairement la violence. Les religions sont fondées sur des *croyances fondamentales et sérieuses* – des convictions sur la nature du monde, l’existence de Dieu, le salut – qui sont par définition exclusives car elles portent des revendications de vérité absolue. Pouivet critique deux approches alternatives. D’abord le *pluralisme religieux**, qui selon lui vide les religions de leur contenu doctrinal en réduisant leurs revendications de vérité à de simples préférences subjectives, comme des goûts esthétiques ou culinaires.
Ensuite **l’inclusivisme* (doctrine de Vatican II avec Nostra Aetate), qui postule un noyau commun à toutes les religions, mais qui reste trop vague pour être doctrinalement significatif. La violence religieuse naît donc de l’exclusivisme social/politique qui se greffe sur les doctrines religieuses, mais n’en découle pas nécessairement. Les religions peuvent cohabiter malgré leurs désaccords doctrinaux fondamentaux. Pouivet illustre son propos en expliquant la notion de tolérance : être tolérant signifie accepter que d’autres aient des croyances que l’on considère comme fausses, non pas être indifférent à leurs croyances. Un chrétien peut penser qu’un musulman ou un juif a tort sur des questions fondamentales tout en respectant parfaitement leur droit à pratiquer leur religion. La laïcité française représente une solution au problème de cohabitation, mais elle a l’inconvénient de minimiser l’importance des revendications de vérité religieuse. Les religions ne peuvent facilement disparaître de l’espace social car leurs adhérents croient détenir des vérités absolues qu’ils souhaitent naturellement partager. En conclusion, Pouivet soutient que la cohabitation des religions est possible mais inévitablement difficile, non pas à cause de l’essence des religions elles-mêmes, mais à cause de leur inscription sociale et des enjeux politiques qui s’y greffent.
Violence et religion.
La question de la violence et de la religion est un sujet complexe et nuancé, qui exige de distinguer les doctrines religieuses de leurs applications sociales, politiques et historiques. Les sources, s’appuyant sur les travaux du philosophe Roger Pouivet (notamment son ouvrage La cohabitation des religions. Pourquoi est-ce si difficile ?), proposent une analyse qui sépare le caractère intrinsèquement conflictuel des religions de la cause fondamentale de la violence.
I. Les Manifestations Historiques et Sociologiques de la Violence Religieuse
Historiquement, l’association de la religion à la violence est manifeste et prend de nombreuses formes :
• Conflits Historiques Majeurs : On peut citer les croisades, les guerres de religion (telles que les Guerres de Religion en Europe aux XVIe et XVIIe siècles), et les persécutions de toutes sortes.
• Conversions Forcées : La colonisation s’est souvent accompagnée de conversions forcées de populations entières en Amérique du Sud, en Amérique du Nord ou en Afrique.
• Violence Contemporaine : Plus récemment, le terrorisme et le massacre de chrétiens au Nigeria témoignent de cette violence.
• Violence Interne : Il existe des violences non seulement entre religions, mais aussi à l’intérieur même des religions. Toute remise en cause des règles internes (le phénomène de l’hérésie) peut entraîner une réaction violente de la part des autorités religieuses, comme cela s’est produit dans l’histoire du christianisme (par exemple, au IIIe siècle, les hérésies réprimées avec brutalité jusqu’aux conciles de Nicée et de Constantinople).
Cependant, une analyse attentive suggère que l’on ne peut pas conclure que les religions sont intrinsèquement violentes.
II. L’Exclusivisme Doctrinal et le Caractère Conflictuel
La véritable nature des religions, selon l’analyse philosophique, est d’être fondamentalement conflictuelles, mais pas nécessairement violentes.
La Revendication de Vérité et l’Orthodoxie Les religions se caractérisent par des croyances fondamentales et sérieuses qui sont constitutives de ce qui est la réalité pour leurs adeptes. Ces croyances portent sur des questions existentielles (ce qu’est le monde, d’où il vient, comment nous devons vivre pour être sauvé). Les croyances sont « sérieuses » car elles sont irrésistibles et ne sont pas modifiables, même face à des arguments contraires.
Puisque chaque religion prétend être la seule vraie (orthodoxie) sur des points fondamentaux et que les doctrines des trois grands monothéismes sont souvent opposées (par exemple, la Trinité chrétienne versus le monothéisme juif et musulman), il y a une raison purement logique au caractère conflictuel :
« Si vous considérez qu’une croyance fondamentale et sérieuse est vraie, vous considérez que tout ce qui la contredit est faux et vous êtes en conflit alors avec tous ceux qui pour vous pensent faux ».
C’est pourquoi les religions sont par nature exclusivistes. Cet exclusivisme doctrinal signifie que, du point de vue d’une foi, toute autre proclamation de foi est considérée comme fausse, voire une infidélité.
La Non-Implication de la Violence Toutefois, l’exclusivisme doctrinal n’entraîne pas forcément la violence entre religions. La revendication de vérité inhérente à toute religion n’implique pas la violence comme une conséquence nécessaire.
Un croyant peut penser que sa religion est la seule vraie sans en conclure qu’il doit éradiquer toutes les autres. La violence à l’égard d’autres religions peut même être interdite par des croyances internes à la propre religion du fidèle.
III. Les Causes Réelles de la Violence : Politique et Sociale (Orthopraxie)
Selon l’analyse, la religion n’est pas la cause fondamentale de la violence, y compris religieuse. Les causes véritables sont souvent politiques, économiques ou sociales, le religieux servant alors de prétexte ou d’alibi.
L’Exclusivisme Social/Politique Ce qui rend la coexistence difficile, ce n’est pas l’exclusivisme doctrinal, mais l’exclusivisme religieux social (ou politique). Cet exclusivisme porte sur les orthopraxies (les pratiques religieuses, les normes qui définissent l’appartenance) et l’inscription historique et sociale des religions.
L’exclusivisme religieux social conduit à interdire ou à rendre très difficile la pratique d’une autre religion dans la vie sociale.
• Priorité Politique : Les guerres de religion en Europe (XVIe et XVIIe siècles) étaient avant tout des querelles politiques et non des divergences religieuses, bien que la religion ait été le motif affiché. L’exclusivisme religieux n’implique même pas de penser que sa religion est la vraie ; il peut être simplement bénéfique pour des raisons politiques d’imposer une religion.
La Graine de la Violence dans l’Homme Au-delà des structures sociopolitiques, il est également souligné que la violence est inhérente à l’homme lui-même, indépendamment de sa pratique religieuse. L’homme, même s’il pratique, est un être ordinaire rempli de violence, et cette violence individuelle n’est pas éradiquée par la pratique religieuse. Cela est en partie lié au fait de se croire au centre du monde.
IV. Dialogue et Coexistence
La coexistence des religions est inévitablement difficile. Le défi du dialogue est d’accepter l’exclusivisme doctrinal sans que celui-ci ne dégénère en violence sociale.
Tolérance vs. Indifférence La notion de tolérance est souvent mal comprise. La tolérance, c’est accepter que les autres aient tort, sans pour autant penser qu’ils ont raison. Si l’on pense que l’autre a raison, on n’est pas tolérant, on est indifférent. Un Chrétien, par exemple, peut être parfaitement tolérant tout en pensant qu’un Juif a tort, car ne pas croire en Jésus Fils de Dieu est constitutif du christianisme.
Le Pluralisme et l’Inclusivisme D’autres approches visent l’harmonie mais rencontrent des difficultés :
• Pluralisme : L’attitude pluraliste, qui voudrait qu’il y ait une pluralité de vérités religieuses ou que la question de la vérité ne se pose pas dans les religions, risque de vider les religions de leur contenu doctrinal fondamental et sérieux. Le pluralisme peut masquer une forme cachée d’exclusivisme, affirmant que la seule thèse correcte est qu’il n’y a aucune vérité religieuse.
• Inclusivisme : La thèse inclusiviste, quasi officielle de l’Église catholique depuis Nostra Ætate, suggère qu’il y a des « semences de vérité » dans toutes les religions. Cependant, si les autres religions n’ont que des semences de vérité, la thèse est plus exclusiviste qu’il n’y paraît. De plus, l’idée d’un noyau commun (comme l’idée que nous avons tous le même Dieu, décrit différemment) est problématique doctrinalement, car elle aboutit à une notion vague, non déterminée, qui relève de la philosophie plutôt que de la religion.
En conclusion, la violence n’est pas une conséquence nécessaire de la revendication de vérité religieuse (orthodoxie), mais plutôt une attitude sociopolitique qui se greffe sur la pratique religieuse (orthopraxie) et qui utilise l’incompatibilité doctrinale comme levier ou prétexte.
Exclusivisme doctrinal.
L’exclusivisme doctrinal est un concept central dans l’analyse de la nature conflictuelle des religions, tel qu’il est développé par le philosophe Roger Pouivet. Il s’agit de la revendication de vérité inhérente à chaque religion, qui pose des difficultés fondamentales pour la coexistence religieuse, sans toutefois être la cause nécessaire de la violence.
I. Définition et Logique de l’Exclusivisme Doctrinal
L’exclusivisme doctrinal concerne l’orthodoxie (la doctrine) d’une religion, par opposition à l’orthopraxie (la pratique).
Croyances Fondamentales et Sérieuses L’exclusivisme doctrinal repose sur le fait que les religions se fondent sur des croyances fondamentales et sérieuses.
• Fondamentales : Elles portent sur des questions existentielles telles que la nature du monde, son origine, sa finalité, la nature de l’être humain, le bien, le mal, et comment vivre pour être sauvé ou vivre éternellement. Ces croyances sont constitutives de ce qui est considéré comme la réalité pour les croyants.
• Sérieuses : Ce sont des croyances irrésistibles et non modifiables. Même face à des arguments contraires, le croyant ne renonce pas à sa foi, persuadé qu’il doit y avoir une réponse à l’argument, même s’il ne la connaît pas (comme l’argument du mal contre l’existence de Dieu).
La Logique de la Vérité Unique La revendication de vérité (l’orthodoxie) conduit à l’exclusivisme par une raison purement logique.
1. Si une croyance fondamentale et sérieuse est considérée comme vraie, tout ce qui la contredit est nécessairement considéré comme faux.
2. Par conséquent, chaque religion pense être la seule vraie et, au regard de cette religion, toutes les autres sont fausses.
3. Toute autre proclamation de foi est considérée comme une infidélité.
Par exemple, le christianisme est constitutif de la croyance que Jésus est le fils de Dieu et qu’il est le Messie. Du point de vue d’un chrétien, un Juif ou un Musulman a tort de ne pas y croire. Les croyances fondamentales des trois grands monothéismes sont non seulement différentes, mais opposées.
II. L’Exclusivisme Doctrinal vs. la Violence
Bien que l’exclusivisme doctrinal rende les religions fondamentalement conflictuelles, l’analyse suggère qu’il n’entraîne pas nécessairement la violence.
La Distinction Cruciale Il est essentiel de distinguer l’exclusivisme des doctrines de l’exclusivisme religieux social ou politique.
• L’exclusivisme doctrinal (concernant la vérité des croyances).
• L’exclusivisme du salut (sotériologique), qui stipule que seule la vraie foi sauve, mais qui peut être modulé par le dogme de l’action divine incompréhensible (la possibilité de « chrétiens anonymes »).
• L’exclusivisme religieux social/politique, qui porte sur les pratiques (orthopraxies) et l’inscription sociale, conduisant à interdire ou à rendre difficile la pratique d’une autre religion dans la vie sociale.
Compatibilité avec la Cohabitation L’exclusivisme doctrinal est parfaitement compatible avec une cohabitation des religions et des incroyants. Penser que sa religion est la seule vraie n’implique pas la conclusion que l’on doive éradiquer toutes les autres. La violence est plutôt le résultat d’une attitude sociopolitique qui se greffe sur une pratique religieuse.
De plus, une religion peut contenir des croyances internes qui interdisent la violence à l’égard des autres religions. Ce qui rend la cohabitation difficile n’est pas l’exclusivisme doctrinal, mais l’exclusivisme social des religieux.
III. L’Exclusivisme face aux Autres Attitudes
L’exclusivisme doctrinal est la position par défaut des religions sérieuses, et s’oppose à deux autres attitudes : le pluralisme et l’inclusivisme.
1. Critique du Pluralisme L’attitude pluraliste prétend qu’il peut y avoir une pluralité de vérités religieuses ou que la question de la vérité ne se pose pas dans les religions. Bien que le pluralisme semble sympathique et favorise l’harmonie, il est difficile à tenir d’un point de vue logique.
Le pluralisme tend à vider les religions de leur contenu doctrinal fondamental et sérieux, les réduisant à de simples préférences subjectives (comme des préférences esthétiques ou culinaires). En réalité, le pluralisme cache souvent une forme d’exclusivisme en rejetant toute revendication de vérité religieuse comme absurde : « la seule thèse correcte, c’est qu’il n’y a aucune vérité religieuse ».
2. Critique de l’Inclusivisme L’inclusivisme (dont Nostra Ætate est un exemple, même si l’interprétation est ambiguë) est la thèse selon laquelle il y aurait un noyau commun ou des « semences de vérité » dans toutes les religions. Cela encourage l’idée que « nous avons tous le même Dieu ».
Cependant, cette thèse est problématique :
• Si les autres religions n’ont que des semences de vérité, cela implique qu’elles n’ont pas la vérité entière, ce qui est une position plus exclusiviste qu’elle n’en a l’air.
• Le concept d’un Dieu commun, décrit différemment (comme l’histoire de l’éléphant touché par des aveugles), aboutit à une notion trop vague et indéterminée de la divinité. Si l’on parle d’un Dieu en général, on tombe dans la philosophie (comme Platon ou Aristote) et non dans une doctrine religieuse spécifique (qui est déterminée par un credo précis).
En conclusion, la revendication de vérité et l’exclusivisme doctrinal sont essentiels à la constitution des religions. Le véritable défi de la cohabitation n’est pas d’éradiquer cette revendication, mais d’empêcher que l’exclusivisme doctrinal ne se transforme en exclusivisme social coercitif.
Cohabitation des religions.
La question de la cohabitation des religions est un sujet intrinsèquement difficile, exploré en profondeur par le philosophe Roger Pouivet dans son ouvrage La cohabitation des religions. Pourquoi est-ce si difficile ?. L’analyse philosophique et historique montre que cette difficulté réside moins dans laLa cohabitation des religions. Pourquoi est-ce si difficile ?*. L’analyse philosophique et historique montre que cette difficulté réside moins dans la nature des doctrines religieuses que dans leur inscription sociale et politique.
I. Le Caractère Inévitablement Conflicuel des Religions
Selon Roger Pouivet, la difficulté de la cohabitation vient du fait que les religions sont fondamentalement conflictuelles. Cette conflictualité est une raison purement logique qui découle de leur nature même, à savoir qu’elles se fondent sur des croyances fondamentales et sérieuses.
L’Exclusivisme Doctrinal (Orthodoxie) Toute religion, par la force de sa doctrine (orthodoxie), prétend être la seule vraie.
• Les croyances portent sur des questions existentielles (ce qu’est le monde, comment être sauvé, etc.) et sont irrésistibles et non modifiables par des arguments contraires.
• Si une croyance est vraie, alors tout ce qui la contredit est faux.
• Par exemple, si un Chrétien croit que Jésus est le fils de Dieu, il doit logiquement penser qu’un Juif ou un Musulman a tort de penser le contraire.
Cet exclusivisme doctrinal signifie que les religions sont exclusives des autres, mais, crucialement, l’exclusivisme doctrinal n’implique pas forcément la violence entre elles.
II. Les Causes Réelles de la Difficulté : L’Exclusivisme Social
Ce n’est pas la revendication de vérité (orthodoxie) qui rend la cohabitation impossible, mais l’exclusivisme religieux social ou politique.
L’Orthopraxie et l’Inscription Sociale Les religions sont des pratiques, des orthopraxies, avec des normes qui définissent l’appartenance. L’exclusivisme social porte sur l’inscription historique et sociale des religions.
C’est cet exclusivisme social qui conduit à :
• Interdire ou rendre très difficile la pratique d’une autre religion dans la vie sociale.
• Utiliser la religion comme prétexte pour des causes qui sont en réalité politiques, économiques ou sociales. Les guerres de religion en Europe aux XVIe et XVIIe siècles, par exemple, étaient avant tout des querelles politiques.
L’exclusivisme social ne suppose même pas que l’on pense avoir la vraie religion ; il peut suffire de penser qu’il est bénéfique pour des raisons politiques d’imposer une religion.
La Violence Inhérente à l’Homme Il est également important de noter que la violence est inhérente à l’homme lui-même, indépendamment de sa pratique religieuse. L’homme qui pratique et qui croit est un être ordinaire rempli de violence, qui n’est pas éradiquée par la pratique. Cette violence individuelle, liée au fait de se croire au centre du monde, est peut-être la racine de la violence qui peut se manifester à travers les religions.
III. Les Approches pour Gérer la Cohabitation
Face à l’exclusivisme doctrinal inévitable, plusieurs attitudes sont envisagées, chacune avec ses limites pour une cohabitation réussie : l’exclusivisme lui-même, le pluralisme et l’inclusivisme.
1. La Tolérance (Compatible avec l’Exclusivisme Doctrinal)
La cohabitation est compatible avec l’exclusivisme doctrinal si celui-ci ne dégénère pas en exclusivisme social. Une attitude de tolérance permet cette coexistence.
• Définition de la Tolérance : Tolérer, c’est accepter que les autres aient tort, ce n’est pas penser qu’ils ont raison.
• Distinction avec l’Indifférence : Si l’on pense que l’autre a raison, on n’est pas tolérant, on est indifférent.
• Un Chrétien peut être parfaitement tolérant tout en pensant qu’un Juif a tort, parce que ne pas croire en Jésus Fils de Dieu est constitutif de sa religion.
2. Le Pluralisme (Risque de Vider le Contenu)
L’attitude pluraliste prétend qu’il peut y avoir une pluralité de vérités religieuses ou que la question de la vérité ne se pose pas dans les religions. Bien qu’elle semble favorable à l’harmonie, elle est difficile à tenir logiquement.
Le pluralisme tend à vider les religions de leur contenu doctrinal fondamental et sérieux, les réduisant à de simples préférences subjectives (comme les préférences esthétiques ou culinaires).
De plus, le pluralisme peut être une forme cachée d’exclusivisme, car il affirme que la seule thèse correcte est qu’il n’y a aucune vérité religieuse (toutes les religions se valent puisqu’elles sont toutes fausses).
3. L’Inclusivisme (Vag et Indéterminé)
L’inclusivisme est souvent considéré comme la thèse quasi officielle de l’Église catholique depuis Nostra Ætate, affirmant l’existence de « semences de vérité » ou d’un noyau commun dans toutes les religions. Cela encourage l’idée que « nous avons tous le même Dieu ».
Cependant, l’inclusivisme est critiqué comme étant problématique :
• Si les autres religions n’ont que des semences de vérité, la thèse est plus exclusiviste qu’elle n’y paraît.
• L’idée d’un noyau commun conduit à une notion d’un dieu en général qui est trop vague et indéterminée pour être une doctrine religieuse spécifique ; elle relève de la philosophie (comme chez Platon ou Aristote) plutôt que de la religion.
IV. La Solution Sociale : la Laïcité
La laïcité à la française est présentée comme une solution qui a permis une certaine paix entre les religions en France. Elle gère la cohabitation en imposant à l’État de ne privilégier aucun culte.
Cependant, cette solution présente un inconvénient : elle tend à éradiquer, minorer ou mettre en question la revendication de vérité religieuse dans la vie sociale. Si une personne pense qu’une chose est absolument vraie (selon sa foi), elle aura envie de le dire. Le risque est que cette laïcité, en imposant l’absence de vérité religieuse reconnue, n’est pas entièrement acceptable des religions.
En conclusion, la cohabitation des religions est inévitablement difficile, non pas à cause des croyances elles-mêmes, mais à cause des facteurs sociopolitiques qui s’en servent comme alibi pour l’exclusivisme social, l’empêchant ou la limitant.
Cohabitation des religions.
La question de la cohabitation des religions est un sujet intrinsèquement difficile, exploré en profondeur par le philosophe Roger Pouivet dans son ouvrage La cohabitation des religions. Pourquoi est-ce si difficile ?. L’analyse philosophique et historique montre que cette difficulté réside moins dans laLa cohabitation des religions. Pourquoi est-ce si difficile ?*. L’analyse philosophique et historique montre que cette difficulté réside moins dans la nature des doctrines religieuses que dans leur inscription sociale et politique.
I. Le Caractère Inévitablement Conflicuel des Religions
Selon Roger Pouivet, la difficulté de la cohabitation vient du fait que les religions sont fondamentalement conflictuelles. Cette conflictualité est une raison purement logique qui découle de leur nature même, à savoir qu’elles se fondent sur des croyances fondamentales et sérieuses.
L’Exclusivisme Doctrinal (Orthodoxie) Toute religion, par la force de sa doctrine (orthodoxie), prétend être la seule vraie.
• Les croyances portent sur des questions existentielles (ce qu’est le monde, comment être sauvé, etc.) et sont irrésistibles et non modifiables par des arguments contraires.
• Si une croyance est vraie, alors tout ce qui la contredit est faux.
• Par exemple, si un Chrétien croit que Jésus est le fils de Dieu, il doit logiquement penser qu’un Juif ou un Musulman a tort de penser le contraire.
Cet exclusivisme doctrinal signifie que les religions sont exclusives des autres, mais, crucialement, l’exclusivisme doctrinal n’implique pas forcément la violence entre elles.
II. Les Causes Réelles de la Difficulté : L’Exclusivisme Social
Ce n’est pas la revendication de vérité (orthodoxie) qui rend la cohabitation impossible, mais l’exclusivisme religieux social ou politique.
L’Orthopraxie et l’Inscription Sociale Les religions sont des pratiques, des orthopraxies, avec des normes qui définissent l’appartenance. L’exclusivisme social porte sur l’inscription historique et sociale des religions.
C’est cet exclusivisme social qui conduit à :
• Interdire ou rendre très difficile la pratique d’une autre religion dans la vie sociale.
• Utiliser la religion comme prétexte pour des causes qui sont en réalité politiques, économiques ou sociales. Les guerres de religion en Europe aux XVIe et XVIIe siècles, par exemple, étaient avant tout des querelles politiques.
L’exclusivisme social ne suppose même pas que l’on pense avoir la vraie religion ; il peut suffire de penser qu’il est bénéfique pour des raisons politiques d’imposer une religion.
La Violence Inhérente à l’Homme Il est également important de noter que la violence est inhérente à l’homme lui-même, indépendamment de sa pratique religieuse. L’homme qui pratique et qui croit est un être ordinaire rempli de violence, qui n’est pas éradiquée par la pratique. Cette violence individuelle, liée au fait de se croire au centre du monde, est peut-être la racine de la violence qui peut se manifester à travers les religions.
III. Les Approches pour Gérer la Cohabitation
Face à l’exclusivisme doctrinal inévitable, plusieurs attitudes sont envisagées, chacune avec ses limites pour une cohabitation réussie : l’exclusivisme lui-même, le pluralisme et l’inclusivisme.
1. La Tolérance (Compatible avec l’Exclusivisme Doctrinal)
La cohabitation est compatible avec l’exclusivisme doctrinal si celui-ci ne dégénère pas en exclusivisme social. Une attitude de tolérance permet cette coexistence.
• Définition de la Tolérance : Tolérer, c’est accepter que les autres aient tort, ce n’est pas penser qu’ils ont raison.
• Distinction avec l’Indifférence : Si l’on pense que l’autre a raison, on n’est pas tolérant, on est indifférent.
• Un Chrétien peut être parfaitement tolérant tout en pensant qu’un Juif a tort, parce que ne pas croire en Jésus Fils de Dieu est constitutif de sa religion.
2. Le Pluralisme (Risque de Vider le Contenu)
L’attitude pluraliste prétend qu’il peut y avoir une pluralité de vérités religieuses ou que la question de la vérité ne se pose pas dans les religions. Bien qu’elle semble favorable à l’harmonie, elle est difficile à tenir logiquement.
Le pluralisme tend à vider les religions de leur contenu doctrinal fondamental et sérieux, les réduisant à de simples préférences subjectives (comme les préférences esthétiques ou culinaires).
De plus, le pluralisme peut être une forme cachée d’exclusivisme, car il affirme que la seule thèse correcte est qu’il n’y a aucune vérité religieuse (toutes les religions se valent puisqu’elles sont toutes fausses).
3. L’Inclusivisme (Vag et Indéterminé)
L’inclusivisme est souvent considéré comme la thèse quasi officielle de l’Église catholique depuis Nostra Ætate, affirmant l’existence de « semences de vérité » ou d’un noyau commun dans toutes les religions. Cela encourage l’idée que « nous avons tous le même Dieu ».
Cependant, l’inclusivisme est critiqué comme étant problématique :
• Si les autres religions n’ont que des semences de vérité, la thèse est plus exclusiviste qu’elle n’y paraît.
• L’idée d’un noyau commun conduit à une notion d’un dieu en général qui est trop vague et indéterminée pour être une doctrine religieuse spécifique ; elle relève de la philosophie (comme chez Platon ou Aristote) plutôt que de la religion.
IV. La Solution Sociale : la Laïcité
La laïcité à la française est présentée comme une solution qui a permis une certaine paix entre les religions en France. Elle gère la cohabitation en imposant à l’État de ne privilégier aucun culte.
Cependant, cette solution présente un inconvénient : elle tend à éradiquer, minorer ou mettre en question la revendication de vérité religieuse dans la vie sociale. Si une personne pense qu’une chose est absolument vraie (selon sa foi), elle aura envie de le dire. Le risque est que cette laïcité, en imposant l’absence de vérité religieuse reconnue, n’est pas entièrement acceptable des religions.
En conclusion, la cohabitation des religions est inévitablement difficile, non pas à cause des croyances elles-mêmes, mais à cause des facteurs sociopolitiques qui s’en servent comme alibi pour l’exclusivisme social, l’empêchant ou la limitant.
Discuss Croyances fondamentales.
Les croyances fondamentales (ou croyances fondamentales et sérieuses) constituent le cœur de la doctrine religieuse (l’orthodoxie) et sont l’élément clé qui rend les religions intrinsèquement conflictuelles, selon les analyses de Roger Pouivet.
Voici une discussion détaillée de ce concept :
I. Définition des Croyances Fondamentales
Une croyance est qualifiée de fondamentale si elle porte sur des questions existentielles et structurantes de la réalité. Ces questions incluent :
• La nature du monde : Ce qu’est le monde, d’où il vient, et quelle est sa finalité.
• La nature humaine : Quelle sorte d’être nous sommes.
• L’éthique et le Salut : Ce qui est bien, ce qui est mal, et comment nous devons vivre pour être sauvé ou vivre éternellement.
Les croyances fondamentales sont constitutives de ce qui est la réalité pour les fidèles. Par opposition, d’autres croyances peuvent être perdues sans affecter l’existence, car elles ne sont pas considérées comme importantes pour l’existence même.
II. L’Aspect « Sérieux » des Croyances
Pour être au cœur d’une religion, ces croyances fondamentales doivent également être sérieuses. Le caractère sérieux d’une croyance implique qu’elle est irrésistible et non modifiable.
Les croyances sérieuses sont :
• Indépendantes des arguments contraires : Tout argument avancé contre ces croyances ne les modifie pas. Par exemple, le croyant peut connaître l’argument du mal (si Dieu est tout-puissant, omniscient et bon, comment le mal est-il possible ?), mais même s’il est incapable d’y répondre, il continue de croire, se disant qu’il doit y avoir une réponse.
• Non renonçables : Ce ne sont pas des croyances auxquelles on va renoncer aisément, ni même renoncer du tout.
Une croyance scientifique en physique, bien que fondamentale (disant comment est la réalité), n’est pas sérieuse dans ce sens, car on peut en changer facilement ou rapidement (comme le passage du modèle newtonien à celui d’Einstein).
III. Le Contenu des Croyances Fondamentales dans les Monothéismes
Les croyances fondamentales et sérieuses caractérisent l’essence d’une religion. Dans les religions chrétiennes, les croyances fondamentales et sérieuses sont énoncées dans le credo.
Pour le christianisme, une croyance fondamentale est :
• Croire que Jésus est le fils de Dieu.
• Croire que Dieu existe et qu’il a un fils qui est Jésus-Christ.
• Ces croyances transforment l’histoire du monde, qui est divisée en deux périodes (avant et après Jésus-Christ), le Messie étant venu en tant que rédempteur.
Pour le judaïsme ou l’islam, ces croyances sont opposées sur des points fondamentaux.
• Un Juif ou un Musulman ne croit pas que Jésus est le fils de Dieu, et pense même que cela est faux.
• De même, un Musulman ou un Juif pense qu’il est faux que Dieu soit une Trinité (Père, Fils et Saint-Esprit), considérant parfois le trinitarisme chrétien comme une forme de polythéisme.
IV. Conséquences : L’Exclusivisme Doctrinal
La revendication de vérité des croyances fondamentales et sérieuses mène à l’exclusivisme doctrinal.
• La Vérité Absolue : Si la vérité est absolue (comme la vérité religieuse l’est pour le croyant), il ne peut pas y avoir des vérités différentes ou qui s’opposent.
• L’Exclusivité Logique : La raison du caractère conflictuel des religions est purement logique : si une croyance fondamentale est vraie, tout ce qui la contredit est faux. Par conséquent, au regard d’une religion, toutes les autres sont fausses.
Cet exclusivisme fait que toute autre proclamation de foi est une infidélité.
V. Croyances Fondamentales et Cohabitation
L’exclusivisme découlant des croyances fondamentales ne rend pas la coexistence impossible, mais difficile.
• Non-Violence Nécessaire : L’exclusivisme des doctrines n’implique pas la violence comme conséquence nécessaire. Il est possible de penser que sa propre religion est la seule vraie sans en conclure qu’il faut éradiquer toutes les autres.
• Critique du Pluralisme : L’attitude pluraliste, qui nie que la vérité se pose dans les religions, est critiquée parce qu’elle vide les religions de leur contenu doctrinal fondamental et sérieux. Elle réduit les doctrines religieuses à de simples préférences subjectives (comme des préférences culinaires ou esthétiques), ce qui est inapproprié pour des croyances essentielles à l’existence.
En somme, les croyances fondamentales et sérieuses sont la source de la conflictualité logique entre les religions, mais la violence est plutôt liée à l’exclusivisme social ou politique qui se greffe sur cette divergence doctrinale.
Pluralisme religieux.
Le pluralisme religieux est une attitude et une thèse qui cherche à gérer la cohabitation des religions en niant ou en minimisant l’importance de la revendication exclusive de la vérité par chaque foi. Selon l’analyse du philosophe Roger Pouivet, le pluralisme, bien qu’apparemment louable, présente des difficultés logiques et risque de vider les religions de leur contenu essentiel.
I. Définition et Intention du Pluralisme
Le pluralisme s’oppose à l’attitude exclusiviste qui caractérise naturellement chaque religion.
Pour les tenants du pluralisme :
1. Il peut y avoir une pluralité de vérités religieuses.
2. La question de la vérité ne se pose pas dans les religions. C’est l’idée que les divergences religieuses ne sont pas une question de vérité.
L’attitude pluraliste est souvent spontanément appréciée. Être qualifié de pluraliste est généralement un compliment, signifiant que l’on est ouvert et que l’on prône le dialogue et la rencontre. Le pluralisme cherche à favoriser l’harmonie.
II. Critique Philosophique du Pluralisme
Roger Pouivet exprime des doutes quant à la viabilité du pluralisme, surtout en matière de religion, le considérant difficile à tenir.
1. La Dévaluation du Contenu Doctrinal Le défaut principal du pluralisme est qu’il tend à supprimer la revendication de vérité, ce qui est pourtant absolument essentiel pour chaque religion.
• Les religions sont des revendications de vérité concernant des croyances fondamentales et sérieuses.
• Si l’on adopte une attitude pluraliste et que l’on renonce à la revendication de vérité, les religions se présentent comme de simples préférences subjectives, comparables à des préférences esthétiques (aimer tel peintre ou telle musique) ou culinaires.
• Ce faisant, le pluralisme vide les religions de leur contenu doctrinal fondamental et sérieux.
• Ce n’est pas dramatique de dire que les fruits de mer sont bons ou mauvais, car ce n’est pas une croyance fondamentale ou sérieuse, mais les croyances religieuses sont décisives et non modifiables.
2. Le Pluralisme est un Exclusivisme Caché Le pluralisme, en tentant de rejeter toute forme d’exclusivisme, aboutit à une forme cachée d’exclusivisme.
• Il consiste à dire que la seule thèse correcte, c’est qu’il n’y a aucune vérité religieuse.
• Toutes les religions se valent non pas parce qu’elles sont toutes vraies, mais parce qu’elles sont toutes fausses en fait.
• Toute revendication de vérité des religions est considérée comme absurde.
• Le pluralisme impose, en quelque sorte, que sa propre thèse soit vraie pour que le système fonctionne.
3. Le Pluralisme et la Laïcité Il est suggéré qu’une forme de laïcisme à la française pourrait parfois revenir à une attitude pluraliste. Si l’État ne privilégie aucun culte, cela peut être interprété comme la supposition qu’il n’y a aucune vérité religieuse (contrairement aux vérités scientifiques, par exemple). Or, cette position, qui mine la revendication de vérité, n’est pas acceptable des religions.
III. Pluralisme face à l’Inclusivisme
Le pluralisme se distingue également de l’inclusivisme, une autre thèse qui cherche à concilier les religions (et qui est devenue la position quasi officielle de l’Église catholique depuis Nostra Ætate en 1965).
L’inclusivisme affirme qu’il existe un noyau commun ou des « semences de vérité » dans toutes les religions. Cette approche encourage l’idée que « nous avons tous le même Dieu ».
Cependant, cette idée est également critiquée :
• Le concept d’un Dieu commun est trop vague et indéterminé. Parler d’un Dieu en général (sans les précisions du credo, comme le fait qu’il est trinitaire pour les Chrétiens) relève de la philosophie (comme chez Platon ou Aristote) et non d’une doctrine religieuse spécifique et déterminée.
• L’inclusivisme risque, tout comme le pluralisme, de conduire à une forme de syncrétisme problématique qui vide chaque religion de son contenu doctrinal.
En conclusion, si l’attitude pluraliste est séduisante car elle prétend favoriser l’harmonie, elle ne prend pas au sérieux l’essence même des religions, qui est leur revendication de vérité exclusive.
Lien de la vidéo conférence : https://www.youtube.com/watch?v=cKsHdupY1KE
Conférences Cordoba : un Eclairage sur les Trois Religions À travers un programme de conférences favorisant découvertes et rencontres, Cordoba permet de mieux comprendre et de décrypter les trois monothéismes, en compagnie des meilleurs spécialistes du monde universitaire et de la recherche.